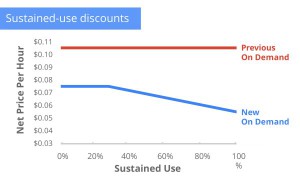Internet fête ses 30 ans. En trois décennies la Toile est devenue aussi indispensable (voire davantage pour les plus jeunes) que l’eau, l’électricité ou le gaz. Dans les années 2000, le développement fulgurant du web à l’échelle planétaire s’est appuyé sur une utopie fondatrice : gratuité, égalité, collaboration. Un bel élan collectif qui déjà portait en germe les quatre facteurs de son propre cancer : marchandisation, cartellisation, discrimination et confidentialité.
Cartellisation tout d’abord. Même si l’architecture originelle initiée par la Défense américaine d’un réseau « décentralisé » – c’est à dire invulnérable à la disparition d’un de ses noeuds – persiste, c’est en fait un projet universitaire collectif qui émerge dans les années 80, encourageant la propagation des connaissances autour d’une idéologie libertaire. Pas tout à fait quand même puisque :
- le contrôle de certaines fonctions centrales du réseau (comme l’attribution des noms de domaine) reste d’obédience américaine,
- les fournisseurs des tuyaux télécom qui « maillent » la planète ne sont pas si nombreux et imposent des points de passage géographiques très concentrés,
- enfin parce que quelques fournisseurs de services web captent la plus grande partie du trafic mondial : requêtes de recherche, vidéos, réseaux sociaux, applications mobiles… tout en imposant leurs conditions d’utilisation.
Discrimination ensuite. Le débat n’est pas nouveau mais il semble maintenant perdu d’avance : ceux qui paieront plus cher seront assis en première classe, les autre seront entassés dernière : moins de bande passante, moins de services ou de fonctionnalités. Quand à ceux qui n’ont pas accès ou qui ne « savent » pas, ce sera l’exclusion – ou la résistance – y compris dans les rapports avec les fonctions régaliennes de l’Etat. Une décision récente de la FAA (le régulateur américain des télécom) vient de l’entériner, cédant aux pressions des fournisseurs d’accès internet sur quelques fournisseurs de contenus qui consomment l’essentiel de la bande passante planétaire comme YouTube ou Netflix. Et il est peu probable que l’Europe entre en résistance face aux géants américains et à l’attrait du divertissement de masse que Netflix s’apprête à diffuser depuis… le havre fiscal luxembourgeois.
Marchandisation : même si les grands acteurs mondiaux ont pour la plupart moins de 15 ans (eh oui, Google, Amazon Web Services, l’iPhone, Facebook n’ont pas vingt ans), même si d’autres n’ont rien vu venir et ont quasiment disparu (Nokia, Sony, IBM …), ce sont avant tout des marchands. Marchands de bande passante pour les fournisseurs télécom. Marchands de données personnelles pour les fournisseurs de services, les moteurs de recherche, ou les éditeurs d’applications. Marchands tout court pour les e-commerçants. Manipulateurs dans tous les cas : avis clients bidons sur Trip Advisor, trolls dans les forums de consommateurs, faux amis Facebook ; voire escrocs : phishing, scams, spam, hoaxes… Impossible d’instaurer un contrôle car personne ne veut d’une police centralisée, et un contrôle efficace par ses pairs suppose un degré de confiance… non marchand.
Confidentialité enfin : inutile de rappeler le scandale Snowden et la faille Heartbleed. L’un sur la surveillance mondiale par la NSA (et d’autres), l’autre sur le SSL, principal protocole de sécurisation des échanges sur la toile. La semaine dernière, ce sont les éditeurs de TrueCrypt qui jetaient mystérieusement l’éponge. Dans tous les cas, la confiance des internautes-citoyens est perdue et ne se retrouvera jamais :
- vis à vis des gouvernements intrusifs et des régulateurs impuissants
- vis à vis des fournisseurs de services qui sont complices plus ou moins passifs
- vis à vis des fournisseurs d’accès qui… vont nous faire payer plus cher sans apporter aucune garantie nouvelle de confidentialité
Alors, Internet, c’est fichu ? Que faire ?
- S’en passer ? Il me semble exclu de convaincre ma fille de 17 ans qu’on peut « vivre sans ».
- Entrer en résistance ? Trop tard, trop surveillé, trop risqué… ce serait retourner s’installer au Larzac.
- Se coaliser ? C’est là qu’est le vrai enjeu. De même que la révolution énergétique engendre une « relocalisation » de la consommation et du contrat social de « frugalité » qui va avec, internet doit se révolutionner. Plus exactement, ses utilisateurs se doivent à eux-mêmes de « réviser » – au sens de l’honnête homme du siècle des Lumières – leurs usages que les gouvernements et les marchands ont proposé plus vite que la société – tant à l’échelle locale que planétaire – ne pouvait les absorber.
Il y a 30 ans l’historien Francis Fukuyama prédisait avec la chute des dictatures militaires et du mur de Berlin la « fin de l’Histoire », en avançant que seule la démocratie libérale satisfait le désir de reconnaissance. Internet a 30 ans, gageons que l’histoire de la Toile ne fait que commencer.
Retrouvez également ces chroniques sur www.cfnews.net/Le-Mag/Chroniques-techno-art-de-vivre